Historique du CRIR
Introduction
Le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR) s’est développé autour d’une vision commune : faire progresser la recherche en réadaptation au bénéfice des personnes vivant avec une déficience physique. Depuis sa création, le CRIR s’est imposé comme un pôle d’excellence, grâce à l’engagement de ses membres, à la richesse de ses partenaires et à l’évolution constante de ses structures de gouvernance.
La frise narrative et la ligne du temps qui suit retracent les grandes étapes de cette transformation, en mettant en lumière les moments clés qui ont façonné l’identité du Centre et renforcé sa mission.
Découvrez également les personnes clés qui ont été à la tête de la direction scientifique du CRIR depuis sa création.
Une infrastructure de fonctionnement et de coordination de la recherche qui a fait ses preuves
Dès sa planification en 1999, le CRIR a créé des postes et des comités pour faciliter le fonctionnement et la gestion des activités de recherche. Plus de 25 ans plus tard, ces cadres de fonctionnement existent toujours. Pour structurer ses activités scientifiques, le CRIR met en place deux comités clés : le comité d’orientation de la recherche (COR), composé de la direction scientifique, des responsables d’axes et d’unités thématiques, des coordonnatrices et coordonnateurs de recherche clinique, ainsi que deux personnes représentant de la communauté étudiante. Le COR propose les grandes orientations de recherche et conseille la direction scientifique. En parallèle, le comité de coordination des sites (CCS) est créé pour assurer la coordination des ressources humaines et matérielles entre les différents sites de recherche. Le CCS réunit la direction scientifique, les responsables de site, la ou le gestionnaire du CRIR et les gestionnaires des établissements membres.
La gouvernance du CRIR : une structure en transformation continue
Dès l’an 2000, le CRIR met en place une structure de gouvernance formelle avec la création de son conseil d’administration (CA). Celui-ci regroupe alors six établissements de réadaptation indépendants, représentés par leurs directions générales et leurs fondations respectives, qui sont des partenaires clés de la recherche : l’Hôpital juif de réadaptation (HJR), l’Institut de réadaptation de Montréal (IRM), la Corporation du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau (CRLB), l’Institut Raymond-Dewar (IRD), le Centre de réadaptation Constance-Lethbridge (CRCL), et l’Institut Nazareth et Louis-Braille (INLB). Trois universités s’y joignent également à titre d’affiliées : l’Université de Montréal, l’Université McGill et l’Université du Québec à Montréal (UQAM). À cette époque, le CRIR compte déjà 46 chercheuses et chercheurs et 151 personnes étudiantes aux cycles supérieurs.
Dès le tout début de sa création, le CRIR collabore avec des centres de réadaptation régionaux en s’associant avec trois établissements partenaires : le Centre de réadaptation Estrie (CRE), le Centre de réadaptation en déficience physique Le Bouclier (CRDPLB) pour les régions des Laurentides et de Lanaudière, et le Centre de réadaptation La Ressource en Outaouais. Plus tard, s’ajoutera le Centre de réadaptation MAB-Mackay (CRMM), qui dessert la clientèle anglophone de plusieurs régions du Québec.
En 2010, dans le but de consolider les volets de la mission universitaire et de soutenir la demande de désignation universitaire, le CA évolue pour devenir le Consortium des établissements de réadaptation exploitant un Institut universitaire (CRIU). Cette transformation marque une étape importante dans la reconnaissance du rôle universitaire du CRIR. Le CRIU se transforme peu de temps après, en raison de la réforme du système de santé de 2015 qui fusionne plusieurs établissements et qui mène à la création du Pôle universitaire en réadaptation (PUR). Ce pôle regroupe les établissements fondateurs sous quatre établissements intégrés, dont les noms sont désormais : l’Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM), le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal (CIUSSS), anciennement IRM, CRLB et IRD ; le Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay (CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal), anciennement CRCL, MAB-Mackay ; l’Hôpital juif de réadaptation (CISSS de Laval) et l’Institut Nazareth et Louis-Braille (CISSS de la Montérégie-Centre). Le Centre de réadaptation en déficience physique, anciennement Le Bouclier, est scindé en deux établissements, à savoir le CISSS des Laurentides et le CISSS de Lanaudière, qui demeurent partenaires du CRIR.
En 2023, une nouvelle entente de gouvernance est signée entre les établissements fondateurs, visant à renouveler le partenariat tout en modernisant et en simplifiant les processus administratifs, en vertu du nouveau cadre légal des établissements. Cette entente donne naissance au comité de gouvernance du CRIR (CGC), qui regroupe ces mêmes établissements, tout en clarifiant les processus permettant d’élargir la portée de la recherche au sein du continuum des services de réadaptation de leurs Centres intégrés universitaires de santé et services sociaux (CIUSSS et CISSS).
Ensemble, ces établissements servent une clientèle de tous âges vivant avec différents types de déficiences physiques affectant la motricité, l’audition, la vision, le langage ou la communication. Cette gouvernance renouvelée reflète l’engagement du CRIR à demeurer un centre de recherche agile, inclusif et ancré dans les réalités cliniques et sociales du Québec.
Les financements du CRIR : des leviers pour l'innovation et l'expansion
Dès ses premières années, le CRIR bénéficie de financements stratégiques qui lui permettent de poser les bases d’un environnement de recherche performant. En 2000, les établissements de réadaptation et leurs fondations, ainsi que le Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ), le Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) apportent un soutien financier majeur à l’infrastructure du centre, marquant le début d’un appui institutionnel à long terme.
L’année suivante, en 2001, le CRIR franchit une étape déterminante en obtenant, conjointement avec le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (Cirris), une subvention majeure de 9,7 M$ (dont 5,9 M$ pour le CRIR) du Fonds canadien pour l’innovation (FCI) et du MSSS. Ce financement, auquel s’ajoutent des fonds de relève FCI attribués à deux chercheuses du CRIR, permet de doubler la superficie des espaces de recherche et d’équiper les laboratoires avec des technologies de pointe. Plus précisément, 6,5 M$ sont investis dans l’achat d’équipements et l’aménagement de nouveaux espaces répartis sur les six sites du CRIR, ainsi qu’au laboratoire de perception visuelle de l’École d’optométrie de l’Université de Montréal.
Grâce à ces investissements, les membres du CRIR disposent désormais de plus de 2 323 m² de locaux comprenant une trentaine de laboratoires spécialisés, des lieux dédiés à la recherche, des ateliers mécaniques et électroniques, des salles informatiques, des salles de réunion et des bureaux.
Ce soutien financier a permis au CRIR de se positionner comme un centre de recherche à la fine pointe, capable d’attirer une communauté de chercheuses et chercheurs de haut niveau et de former une relève scientifique dynamique.
Plus récemment, en 2017, le CRIR a obtenu une autre subvention majeure de 4,9 M$ pour le programme Brilliant-Rehab (Biomedical Research and Informatics Living Laboratory for Innovative Advances of New Technologies in Community Mobility Rehabilitation). Ce projet a développé des infrastructures biomédicales pour des traitements de pointe en laboratoire, jumelées à des solutions de santé numérique pour améliorer la collecte de données en contexte de réadaptation en clinique et dans la communauté. Ce programme illustre la capacité du CRIR à innover en réponse aux enjeux contemporains de la recherche en santé.
Encore aujourd’hui, il est intéressant de noter que les espaces physiques du CRIR continuent de se moderniser et de s’agrandir (4 087 m2) pour s’adapter à la croissance constante de ses membres. Une bonne partie de la recherche se déroule dorénavant en mode virtuel ou bimodal (en personne et virtuel), ce qui incite à revoir les modes de partage des espaces de recherche.
Le CRIR est aujourd’hui l’un des plus grands centres de recherche en réadaptation au Canada!
1997 : Les premiers pas du CRIR
C’est à l’automne 1997 que le Fonds de recherche Santé Québec (FRSQ) s’entend avec les chercheuses et chercheurs ainsi que les personnes administratrices d’établissements pour élaborer un plan de développement de la recherche en vue de la création d’un centre de recherche multisite et interdisciplinaire en réadaptation à Montréal : le Regroupement des établissements de réadaptation en déficience physique de Montréal (RERDPM).
Ce plan est déposé aux FRSQ et au Conseil québécois de la recherche sociale à l’automne 1999 et accepté par ces organismes le 1er avril 2000.

Mai 2000 : Reconnaissance officielle du CRIR
La reconnaissance du CRIR est désormais officielle!
Le CRIR a pour ambition de mieux répondre aux besoins des personnes de tous âges ayant une déficience physique. Il a pour mission d’ « optimiser la capacité et la performance fonctionnelles, la participation et l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience physique par la recherche dans les domaines biomédical et psychosocial de la réadaptation ».
Sa nouvelle identité visuelle est créée.
Jusqu’à ce jour, le CRIR est dirigé par une co-direction scientifique qui représente l’Université de Montréal et l’Université McGill.

2000 : Programme Nouvelles Initiatives
Ce concours a été créé pour stimuler la recherche clinique et l’implication des cliniciennes et cliniciens dans la recherche. Il vise à catalyser le démarrage de nouveaux projets de recherche en réponse à des questions provenant du milieu clinique, en soutenant la rédaction des protocoles de recherche sur des enjeux originaux ou la formation de nouvelles équipes de recherche. Les projets multisites ou interaxes sont favorisés, tout comme les collaborations intersectorielles faisant appel à des partenaires externes pour améliorer les soins et services.
En 25 ans d’existence (2000-2025), ce programme a permis de subventionner près de 150 projets de recherche pour un montant total de près de 1,0 M$, en plus de voir naître de belles collaborations entre les membres chercheurs et cliniciens du CRIR.
Septembre 2002 : Mise en place du Comité d'éthique de la recherche des établissements du CRIR
En 2001, le CRIR a fait face à des défis administratifs pour ses projets multicentriques, notamment la multiplication des évaluations éthiques du fait de ses affiliations avec six établissements de santé et trois universités. Pour y remédier, l’idée d’une évaluation unique reconnue par toutes les partenaires et tous les partenaires émerge. Après concertation avec les directions générales, un comité d’éthique de la recherche commun est créé le 4 septembre 2002 le Comité d’éthique de la recherche des six établissements du CRIR (CER-CRIR). Chaque conseil d’administration doit nommer ses membres, renouveler leurs mandats et adopter le rapport annuel du CER-CRIR. Un règlement encadre l’évaluation des projets impliquant des personnes participantes. Le CER-CRIR innove avec l’examen de la convenance institutionnelle, processus qui est éventuellement adopté par tous les CER du Québec. Pour répondre aux exigences du Plan d’action ministériel en éthique de la recherche (PAM 1998), un Comité d’évaluation scientifique conjoint est aussi mis en place.
En savoir plus dans cette vidéo :

2007 : Réaménagement des axes et unités thématiques de recherche du CRIR
À l’automne 2007, le CRIR a procède à une réorganisation majeure de ses axes et unités thématiques de recherche. Depuis sa création, le centre était structuré autour de trois axes thématiques renommés en 2003 : (1) Fonctions sensorimotrices et déplacements, (2) Communication, fonctions sensorielles et psychologiques, et (3) Soins, services et programmes en adaptation-réadaptation, regroupant huit unités thématiques.
Cette structure évolue pour s’articuler désormais autour de deux axes : l’axe 1 « Fonctions et activités sensorielles, motrices et cognitives » et l’axe 2 « Participation, inclusion sociale et services de réadaptation », regroupant quatre unités thématiques. Par ailleurs, les besoins exprimés dans une approche interdisciplinaire, intersectorielle et proactive sont été intégrés dans les trans-axes prioritaires selon trois thèmes transversaux : (1) le transfert des connaissances ; (2) les technologies et aides techniques ; (3) la promotion de la santé, du bien-être et la prévention des incapacités.

2011-2015 : Laboratoire vivant en réadaptation (RehabMaLL) au centre commercial Alexis Nihon
En 2011, grâce au financement du programme « Projet stratégique de développement innovant » des Fonds de Recherche du Québec (FRQ), le CRIR lance le tout premier projet de recherche interdisciplinaire et multisectoriel en réadaptation. Ce projet novateur vise à identifier les principaux obstacles physiques et psychosociaux à la participation sociale et à l’inclusion des personnes vivant avec une déficience physique, dans le contexte d’un centre commercial : le centre commercial Alexis Nihon (Cominar). S’appuyant sur une approche de laboratoire vivant (Living Lab), plus de 60 projets sont menés, mobilisant les membres chercheurs, cliniciens et étudiants du CRIR, ainsi que des partenaires communautaires et associatifs. Ces initiatives contribuent à transformer l’environnement du centre commercial, entraînant une hausse significative de la fréquentation des personnes ayant une limitation fonctionnelle, qui est passée de 6% à 23%, dans le cadre de l’initiative RehabMaLL.
En savoir plus sur le laboratoire vivant :

2013 : Développement des six dimensions de la mission universitaire
Élément central depuis le début de la création du CRIR, l’objectif de devenir un institut universitaire se poursuit en 2013 avec la formation de comités de travail portant sur l’Évaluation des technologies et des modes d’intervention en réadaptation, les Pratiques de pointe, et le Transfert des connaissances. Ce comité vient s’ajouter à la structure d’enseignement et de recherche déjà présente au sein de chacune des établissements membres du CRIR.
Cette étape est le pilier de la création d’un institut universitaire. Des ressources communes sont allouées à l’Évaluation des technologies et des modes d’intervention et sont financées par le Consortium des établissements de réadaptation qui exploitent un institut universitaire.
2015 : Désignation de l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM)
En juillet 2015, le CIUSSS-Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (CCSMTL) obtient du ministère de la Santé et des Services sociaux une désignation universitaire liée à la réadaptation en déficience physique. Cette désignation a donné naissance à l’Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal (IURDPM) qui permet de déployer les six dimensions de la mission universitaire (recherche, enseignement, pratiques de pointe, transfert de connaissances, rayonnement, et évaluation des technologies et des modes d’intervention) de manière à engendrer l’innovation nécessaire pour améliorer en continu l’offre de services de réadaptation à la population québécoise.

2017 : Création de l'initiative Société inclusive
Vers une société québécoise plus inclusive est une initiative de recherche participative et intersectorielle, dont le but est de favoriser la création d’environnements physiques et sociaux plus inclusifs pour les personnes ayant des incapacités. Cette initiative est née de la volonté de quatre organisations, soit le Réseau provincial de recherche en adaptation-réadaptation, le CRIR, le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale et le regroupement stratégique INTER, de mettre en commun leurs expertises afin d’aborder des problèmes sociétaux prioritaires pour les personnes vivant avec des incapacités. Dans la suite logique du laboratoire vivant RehabMaLL, cette initiative soutient des projets de recherche où collaborent des partenaires du monde associatif, municipal, culturel, privé et de la santé, avec des chercheuses et chercheurs universitaires. De 2017 à 2023, l’initiative Société inclusive a été financée par les FRQ. Depuis 2023, la Fondation Azrieli ainsi que la Fondation Mirella et Lino Saputo soutiennent Société inclusive.
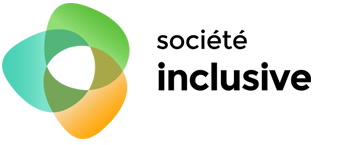
2018 : Intégration des chercheuses d’établissement
Le premier poste de chercheuse d’établissement est créé en 2018 à l’IURDPM du CCSMTL avec l’arrivée de Diana Zidarov. S’en suit la création de deux autres postes : Celui de Frédérique Poncet, en 2020, au Centre de réadaptation Lethbridge-Layton-Mackay du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’île de Montréal grâce au soutien de la Fondation Habilitas, et celui de Tatiana Ogourtsova, de 2021 à 2025, à l’Hôpital juif de réadaptation du CISSS de Laval grâce au soutien de la Fondation de l’Hôpital juif de réadaptation.
Les chercheuses d’établissement du CRIR ont un vaste mandat, dont celui de mener des études en réadaptation physique selon leurs expertises, en collaboration avec des partenaires cliniques, administratifs et communautaires.
Elles soumettent des demandes de subventions, rédigent des articles scientifiques, partagent les résultats de leurs recherches lors de présentations et conférences, en plus de superviser des personnes étudiantes.

2020-2021 : 20e anniversaire du CRIR et lancement des Prix de reconnaissance Eva Kehayia et Bonnie Swaine
Le CRIR célèbre ses 20 ans dans l’innovation et la reconnaissance!
En 2020-2021, le CRIR célèbre deux décennies d’excellence en recherche en adaptation-réadaptation avec une série d’activités marquantes et de reconnaissance :
- un premier congrès scientifique en ligne « Catalyseur d’innovation pour la réadaptation de demain » (100+ présentations);
- une conférence grand public inspirante avec Bean Gill;
- la série de conférences « Apprendre à se connaître » pour rapprocher les établissements membres;
- le lancement de l’outil de mobilisation de connaissance, Le CRIR Branché;
- et la Campagne des MERCI pour saluer l’engagement des membres cliniciens et du personnel de recherche.
Deux prix de reconnaissance voient aussi le jour :
- Le Prix de reconnaissance Eva Kehayia |Début de carrière prometteuse en recherche, destiné à une ou un jeune chercheur prometteur pour ses premières contributions remarquables à la recherche en réadaptation.
- Les Prix de reconnaissance Bonnie Swaine | Partenariat et mobilisation des connaissances, honorent des membres cliniciens ayant joué un rôle clé dans le développement de partenariats et la mobilisation des connaissances.

2023 : Début du Carrefour des savoirs
Le Carrefour des savoirs est issu d’un consortium de cinq centres de recherche montréalais en santé et en services sociaux : le CRIR, le Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, le Centre de recherche en santé publique, le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie sociale et l’Institut universitaire SHERPA – Immigration, diversité, santé.
Grâce au soutien des FRQ – secteur Santé, cette initiative vise le développement professionnel des étudiantes et étudiants des cycles supérieurs afin d’améliorer leurs perspectives d’emploi. À travers des ateliers, du mentorat et des stages, l’objectif est de permettre à la communauté étudiante de parfaire ses compétences transversales (communication, leadership, créativité, etc.)

2025 : 25e anniversaire du CRIR et lancement de la Bourse de soutien à l’innovation Forget-Bélanger
Ensemble pour un futur inclusif depuis 25 ans!
Pour marquer ce quart de siècle d’innovation en recherche en réadaptation, le CRIR se met en dialogue avec la communauté par une série d’initiatives inspirantes alliant art et science. Une première exposition itinérante, « Ensemble pour un futur inclusif », s’intègre à différents événements grand public de nos partenaires, avec des kiosques interactifs captivants rejoignant des milliers de personnes touchées ou non par une situation de handicap ainsi que leur entourage. L’audace de nos stratégies signale un tournant dans notre approche de vulgarisation scientifique : bistros, complexes sportifs, salons d’exposition, foires scientifiques, et halls d’entrée de nos établissements partenaires deviennent notre terrain de vulgarisation.
Cette année marque aussi le lancement de la Bourse de soutien à l’innovation Forget-Bélanger, en partenariat avec Robert Forget, son épouse Céline Bélanger, la Fondation de l’Institut Nazareth et Louis-Braille et la Fondation RÉA. Cette bourse annuelle soutient une personne étudiante au doctorat ou postdoctorale dont les travaux promettent de transformer les pratiques en réadaptation.
En 2025, le CRIR est une structure multidisciplinaire exceptionnelle de 124 chercheuses et chercheurs réguliers et associés répartis en deux axes de recherche, plus de 193 membres cliniciens/intervenants qui collaborent à divers projets de recherche, et plus de 400 étudiantes et étudiants. Les équipes de recherche sont regroupées dans plus de 60 laboratoires et groupes de recherche situés dans les quatre sites du CRIR.
Notre communauté est en effervescence et tournée vers un avenir toujours plus inclusif et innovant!

Codirecteur scientifique du CRIR de 2000 à 2009, il est professeur honoraire à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal (UdeM) où il a enseigné 27 ans en physiothérapie à l’École de réadaptation. Diplômé en physiothérapie à l’Université McGill, il obtient un doctorat en sciences neurologiques de l’UdeM et suit des formations postdoctorales à Paris (neurophysiologie) et aux Pays-Bas (psychophysiologie). De 1989 à 2001, il est chercheur-boursier des Fonds de la recherche en santé du Québec.
Son principal intérêt en recherche est l’intégration sensorimotrice lors de la posture et du mouvement chez l’humain. Il a étudié l’apport des sensibilités somesthésiques et visuelles à la motricité, l’adaptation et l’excitabilité du système nerveux central (SNC) et les interventions utilisant les influx somesthésiques lors d’atteintes neurologiques (désafférentation, AVC, traumatisme crânien ou amputation).
En 1998-1999, il met sur pied le CRIR où il sera co-directeur scientifique de 2000 à 2009. M. Forget est directeur des programmes de physiothérapie de l’UdeM de 2009 à 2016 où il crée le premier programme universitaire québécois pour physiothérapeutes formés à l’étranger. Pour son leadership en éducation professionnelle et en recherche, il a reçu, entre autres, le Prix Excellence (2000), le Prix Carol Richards (2015) et le titre de Fellow (2021) de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec et la Médaille de carrière de la Faculté de médecine de l’UdeM (2016).

Codirectrice scientifique du CRIR de 2000 à 2020 et de l’Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (IURDPM-CCSMTL) de 2015 à 2020, elle est professeur agrégée et directrice de recherche à l’École de physiothérapie et d’ergothérapie de la Faculté de médecine de l’Université McGill, codirectrice de recherche du Centre de recherche Feil Oberfeld/CRIR–Hôpital juif de réadaptation du CISSS de Laval, affilié à l’Université McGill, et chercheuse au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain (CRIR).
Impliquée dans la direction de d’initiatives d’envergure depuis plusieurs années, elle codirige actuellement une initiative de partenariat pancanadienne financée par le Conseil de recherches en sciences humaines et intitulée « Les mots dans le monde » (2025). Elle a exercé un rôle de codirection au sein de l’initiative d’innovation stratégique intitulée : The RehabMaLL — A Rehabilitation Living lab : Creating enabling environments for social participation and inclusion for individuals with physical disabilities (RehabMaLL initiative), et a contribué à la codirection du volet canadien (McGill University-Université de Montréal-CRIR Living Labs) du projet VITALISE d’Horizon 2020 VITALISE – ENoLL, qui rassemble des laboratoires vivants de santé et de bien-être en Europe et au Canada (2021-2025).
Ses projets visent à explorer les mécanismes sous-jacents qui limitent le langage et de la communication chez les personnes atteintes de maladies neurologiques acquises et dégénératives et à accroître l’accessibilité, la participation et l’inclusion de tous et toutes, en particulier des personnes vivant avec des handicaps physiques. Au cours des cinq dernières années, elle s’est aussi concentrée sur des projets visant à améliorer l’accessibilité et l’inclusion des personnes handicapées dans les environnements de loisirs, en particulier les musées au Canada et en Europe.

Codirectrice scientifique du CRIR de 2009 à 2020 et de l’Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (IURDPM-CCSMTL) de 2015 à 2020, elle détient un doctorat en sciences biomédicales (réadaptation) et a aussi complété un postdoctorat à l’Université McGill (épidémiologie et biostatistiques). Elle est professeure honoraire à l’École de réadaptation de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal et a été la directrice de l’École de 2020 à 2024. Son laboratoire était situé à l’IURDPM du CCSMTL.
Une part importante de ses travaux de recherche de cette physiothérapeute de formation porte sur l’amélioration de la prise en charge des enfants et des adultes ayant subi un traumatisme craniocérébral (TCC) ainsi que sur la neuro-réadaptation. Elle a mené des recherches épidémiologiques sur le risque d’un deuxième TCC chez les enfants et sur le risque de suicide après un TCC, ainsi que sur les services liés à la santé mentale. La plupart de ses recherches sont menées en étroite collaboration avec des cliniciennes et des cliniciens et des gestionnaires de la province, du Canada et de l’Europe et comprennent l’évaluation de la qualité des services de réadaptation (incluant la danse-thérapie), le développement d’outils d’évaluation et le transfert de connaissances. Elle a été coresponsable scientifique de l’élaboration des lignes directrices cliniques sur les TCC avec la Fondation ontarienne de neurotraumatologie et l’initiative RehabMaLL, un laboratoire vivant de réadaptation situé dans un centre commercial.

Codirecteur scientifique du CRIR et de l’Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (IURDPM-CCSMTL) de 2000 à aujourd’hui, il détient un doctorat en neurosciences de l’Université de Montréal, et a complété un stage postdoctoral en neurophysiologie à Università di Roma ‘La Sapienza’ en Italie. Il est professeur titulaire à l’École de physiothérapie et d’ergothérapie, Faculté de médecine de l’Université McGill. Son laboratoire est situé à l’Hôpital juif de réadaptation du CISSS de Laval.
Ergothérapeute de formation, il s’intéresse au développement et à l’évaluation des technologies en réadaptation. Plus particulièrement, ses travaux portent sur l’utilisation de la robotique et de la réalité virtuelle pour la réadaptation de personnes qui ont subi un accident vasculaire cérébral. Notamment, la robotique permet l’assistance physique des mouvements du bras; la réalité virtuelle offre alors un environnement motivant dans lequel la personne ayant une incapacité physique peut pratiquer des tâches de la vie quotidienne.
Il dirige également des recherches portant sur le développement et l’évaluation de simulateurs pour l’entraînement en fauteuil roulant, fauteuil motorisé et quadriporteur.
Depuis 2017, il dirige l’initiative intersectorielle provinciale « Société inclusive ». Cette initiative vise à améliorer l’inclusion sociale de personnes en situation de handicap, au moyen de la recherche participative. Société inclusive finance et soutient des équipes de recherche formées de partenaires communautaires en collaboration avec des chercheuses et chercheurs universitaires.

Codirectrice scientifique du CRIR et de l’Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (IURDPM-CCSMTL) de 2020 à aujourd’hui, elle détient un doctorat en sciences biomédicales (réadaptation) et a complété un postdoctorat à l’Université McGill (informatique de la santé) et à l’Université de la Colombie-Britannique (sciences de la réadaptation). Elle est professeure titulaire à l’École de réadaptation de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal. Son laboratoire est situé à l’IURDPM-CCSMTL.
Ergothérapeute de formation, elle gère un programme de recherche pancanadienne qui recourt à l’informatique de la santé pour améliorer l’accès, l’attribution, le suivi et l’entraînement des personnes vivant avec une déficience motrice ou sensorielle qui utilisent des aides techniques et leurs proches aidants. Ses méthodologies participatives centrées sur les utilisateurs et leur écosystème l’amènent à développer des partenariats avec des entreprises, des partenaires cliniques et communautaires au Canada et outremer.
Par ailleurs, elle dirige une initiative de réseautage ciblant le transfert de connaissances sur les approches méthodologiques pour évaluer l’utilisabilité des technologies de réadaptation. Son expertise est reconnue au sein de comités nationaux et internationaux en lien avec ces thèmes de recherche.




